«Du bon usage de la nature : pour une philosophie de l‘environnement »

Pour Protagoras ( 485-420 av JC), « l'homme est le laissé pour compte de la nature dépourvue de ce qui est nécessaire à sa vie ,c'est pourquoi il devrait disparaître... S'il survit, c'est qu'il s'est doté d'une technique capable de subvertir la nature défaillante et que des sociétés se sont formées... C'est pourquoi les hommes ont besoin de la cité, du lien conventionnel que les citoyens établissent entre eux en participant également au pouvoir … ». Protagoras considère la nature comme le milieu naturel qu'il qualifie d'hostile pour la vie humaine. Seule la vie en société et la civilisation et son pouvoir central permet de mobiliser les forces et les hommes pour développer des techniques et aménager le milieu naturel afin de le rendre productif. On reconnaît là l'idée d'utilisation et d'usage de la nature et de sa modification pour assouvir les besoins humains.
La Natura naturata : une nature en équilibre crée par dieu dont les hommes peuvent disposer
La physique du XXéme siécle ,et ses nouvelles découvertes; induit une remise en cause radicale de la science moderne et de sa conception de la nature comme un ensemble de choses qui obéissent à des lois physiques et mathématiques universelles et nécessaires. L'idée d'une nature stable est dépassée : la nature est dynamique, chaotique et imprédictible. L'écologie va prendre la relève de l'histoire naturelle et poursuit l'enquête sur les formes d'organisations du vivant comme sur les processus de la Natura naturans. Le terme d’écologie à été inventé en 1866 par Ernst Haeckel (1834-1919) : il signifie économie de la nature. Le principe du holisme ,énoncé par Emile Durheim (1858-1917) ,dit qu'on connaît un être quand on connaît l'ensemble, la totalité, du système dont il est une partie. Ce point de vue s'oppose à la biologie réductionnisme qui considère l'organisme comme un tout que l'on explique que par les propriétés de de ses composantes . Le holisme sera adopté en sociologie comme en écologie qui s'amorce comme une science attachée prioritairement à l'étude des relations avant celle des objets. Une critique peut etre énoncé à l'égard de l'écologie systémique : comme dans la vision moderne elle est incapable d'intégrer l'homme dans ses recherches. En 1935, Tansley (1871-1955) invente le concept d'écosystème : c'est un modèle qui permet d'intégrer les végétaux, les animaux et les facteurs du milieu. Il envisage également d'appliquer le principe de l'écologie aux espaces anthropisés et ils le sont tous plus ou moins. Ainsi les pratiques humaines seraient intégrées dans l'étude des écosystémes. Mais inclure l'homme dans l'analyse écosystémique s'avère extrêmement difficile car l'homme et ses activités n'ont pas d'ajustement automatique à un contexte de sélection, il s'agit à l'inverse de stratégies intentionnelles. Les logiques sociales ,économiques et culturelles qui président à la diversité des actions échappent à l'analyse de l'écologue.
Le processus d’extinction d’espèces tient à la sélection naturelle amplifiée par les formes humaines de mise en valeur : prélèvements successifs de certaines espèces, déboisements des forets ombrophiles tropicales, urbanisation et infrastructures fragmentant les habitats, pollutions et utilisation de pesticides, développement de l’agriculture intensive au détriment des agricultures traditionnelles. La première loi de protection de la nature de 1976 en France semble inefficace dans bien des cas. La plupart des espèces ne sont menacées ni par la chasse, ni par la cueillette, ni par la malveillance mais bien par la disparition de leurs milieux qui leur étaient favorables. La plupart des espèces à protéger appartiennent pour la plupart à des stades intermédiaires des successions biocénotiques, maintenues en équilibre par les activités humaines. On ne se contente donc pas de « laisser faire la nature » mais de bloquer la dynamique spontanée d’un écosystème ou d’un agrosystème. Protéger des milieux, c’est maintenir des activités, c’est éviter qu’elles ne se transforment ou que l’on ne les abandonne : la nature est gérée.
Pendant longtemps en France, l’opinion dominante fut qu’en matière d’environnement on n’avait pas besoin d’éthique : le recours à l’expertise suffisait. A partir des années 70, on vient à admettre la dimension éthique de notre rapport à la nature, par souci moral car nous en sommes responsables devant les générations futures. Hans Jonas introduit de telles idées en 1979 en appelant à une nouvelle définition de la responsabilité qui ne soit pas seulement l’imputation d’un acte passé, mais un engagement à l’égard d’un avenir dont il reculait le plus vite possible. Il y a du point de vue éthique une obligation de savoir, qui passe par une reconnaissance de notre ignorance : nous ne possédons pas le savoir scientifique des effets futurs de nos actions actuelles. En Allemagne apparaît également le principe de précaution : « il peut être justifié, ou il est impératif de limiter, encadrer ou empêcher certaines actions potentiellement dangereuses sans attendre que le danger soit scientifiquement établies ». Il devient le principe fondateur du droit de l’environnement avec le rapport Bruntland sur le développement durable, en 1988 et le dixième des grands principes retenue au sommet de rio. Avec la précaution, la raison prend le pas sur la peur et ouvre l’espace du débat public. Elle fait appel à la délibération et le modèle en est celui du débat public. Avec ces principes apparaît également la notion de patrimoine naturel, qui introduit le long terme. A partir du moment ou ils ont intégré la notion de patrimoine, les écologues ont fait du « milieu » naturel, un paysage, une structure spatiale qui résulte de l’interaction entre des processus naturels et des activités humaines. C’est cette nature façonnée par l’homme que nous voulons transmettre. La filiation et le commun convergent vers une même idée : celle du bon usage. La gestion en père de famille est le modèle d’une conduite prudente, avisée, lente, visant la continuité, qui ne gaspille pas. Mais une question reste en suspend : Quels paysages voulons nous transmettre ? Ceux que nous avons reçues, ceux que nous avons transformés, et selon quels critères? Selon les auteurs, une chose est juste quand elle tend à préserver, ou augmenter, la diversité biologique. Elle est injuste quand il en va autrement. C’est en tout cas ce vers quoi tendent les gestionnaires d’espaces naturels aujourd’hui. Comme Barbault l’énonce : « la diversité est la base de l’adaptabilité des êtres vivants et peut être des systèmes écologiques et de la biosphère toute entière, face aux changements qui peuvent affecter leur environnement ». La maintenir semble être nécessaire à la résilience de la vie après des perturbations de grande ampleur.
A l’époque contemporaine, l’homme n’est plus extérieur à la nature, il en fait partie. Il devient membre actif d’une nature, à laquelle il peut faire du bien, s’il en fait bon usage. A présent, il est prouvé que la diversité biologique locale repose en grande partie sur les pratiques culturales, et culturelles des populations et des sociétés paysannes qui l’ont préservé ou contribué à la développer.
La notion de développement durable peut servir de règle de bon usage de la diversité biologique, conciliant le libre accès à celle-ci et le maintien sur place de population dont les compétences recevraient leur rémunération associant la justice au respect de la valeur intrinsèque d’un élément naturel.
Grace à se vision éco-centrée, l’ouvrage “ Du bon usage de la nature” invite au débat concernant l’action de l’homme sur une nature dont il fait partie. Il permet de s’interroger sur les règles du bon usage qui doivent permettre de conserver la biodiversité avec des pratiques en équilibre avec le fonctionnement des écosystèmes, plus ou moins anthropisées en agrosystèmes. Son épistémologie de l’environnement depuis l’antiquité est très précise et les réferences bibliographiques sont trés nombreuses, invitant à s’interresser à d’autres auteurs emblématiques ayant marqués l’évolution du concept de nature et de la politique de protection de la nature, comme Aldo Leopold. Je pense que cet ouvrage permet d’apaiser les esprits et de sortir du discours alarmiste d’un homme destructeur et trés nocif pour l’environnement. Certes aujourd’hui, il est prouvé que certaines des activités humaines sont très dangereuses pour la vie ,au niveau global comme au niveau local, mais il ne faut pas omettre dans toutes recherches concernant le paysage et la biologie, que l’homme peut etre un facteur de diversité biologique et favoriser sa création et son maintien.
Sébastien SOL - décembre 2006
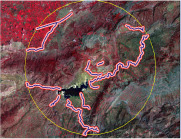

Commentaires