La peur de la nature
 La peur de la nature (1988) et La civilisation anti-nature (1994) de François Terrasson forment un plaidoyer informé et talentueux en faveur d’une éthique environnementale toute orientée vers la préservation d’une nature sauvage sans l’homme. Au travers de ces ouvrages, il tente de déterminer, par la psychologie, les causes profondes de destruction des milieux naturels par nos sociétés et dresse une critique très intéressante de la politique de protection de la nature en France, qu’il considère comme un véritable échec.
La peur de la nature (1988) et La civilisation anti-nature (1994) de François Terrasson forment un plaidoyer informé et talentueux en faveur d’une éthique environnementale toute orientée vers la préservation d’une nature sauvage sans l’homme. Au travers de ces ouvrages, il tente de déterminer, par la psychologie, les causes profondes de destruction des milieux naturels par nos sociétés et dresse une critique très intéressante de la politique de protection de la nature en France, qu’il considère comme un véritable échec.Un paysan au muséum[1]
Né le 3 juillet 1939 à Saint-Bonnet-de-Tronçais dans l’Allier, F. Terrasson grandit en lisière de la grande forêt du Tronçais et du bocage. Très jeune, il découvre le goût des ballades solitaires dans les milieux qui l’environnent « au milieu des forces occultes des chênes centenaires et des marais sombres et nauséabonds » [2]. Il devient rapidement un naturaliste averti. Après une très brève carrière d’instituteur, il s’engage dans des études très variées comme les sciences naturelles, l’ethnologie, l’histoire des religions, la linguistique, la sociologie rurale et la pédagogie qui lui ouvrirons les voies de la pluridisciplinarité.
Après différents travaux à l’étranger pour des organismes de recherche comme l’ORSTOM (actuellement IRD), il intègre le Muséum d’Histoire Naturelle en 1967 en tant qu’assistant au Service de la conservation de la nature. Fervent défenseur du bocage, il se spécialise dans les années 70 en agro-écologie et travaille sur les questions de remembrement qui concernent une grande partie du pays. Ces travaux de terrain et sa pluridisciplinarité le poussent à chercher les raisons sociales de la transformation brutale des milieux par nos sociétés. Ainsi, il s’interroge sur les représentations culturelles de la nature et leurs relations avec les paysages. Au carrefour des sciences humaines et des sciences de la nature, F. Terrasson exerça un très grand nombre d’activités telles que Maître de conférence au Muséum d’Histoire Naturelle, écrivain, journaliste indépendant ou encore photographe.
Décédé le 2 janvier 2006, il bouscula les mentalités par ses idées dérangeantes sur la protection de la nature et son approche « d’ethnopsychonaturaliste » pour rechercher « au plus profond de notre inconscient, les vraies causes de la destruction de la nature ».
Une politique de protection de la nature ayant révélé ses limites
Les travaux de Terrasson se situent dans un contexte de crise environnementale et de développement d’une protection de la nature en France qu’il remet grandement en cause. Depuis 1976, les principales lois de protection de la nature ont évolué, passant d’une nature sanctuarisée « mise sous cloche » à une nature gérée favorisant la biodiversité et les espèces rares, menacées ou dites patrimoniales. Cette protection prît essentiellement la forme d’outils réglementaires tel que les espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles…) et les listes de protection d’espèces. Mais protéger la nature en France, c’est avant tout conserver des activités traditionnelles agricoles ayant favorisé l’apparition et le maintien d’espèces que l’on dit « patrimoniales » dans ces paysages. A coté de ces zones empruntes d’activités humaines résident des zones que l’on souhaite sauvage où la gestion est minimale voire nulle, afin de conserver les dynamiques naturelles des écosystèmes. Ces espaces sont souvent nommés « Réserve Intégrale ». Malgré tous ces outils et stratégies de protection, la diversité des espèces continue à régresser prouvant les limites d’une politique ayant favorisé la conservation de certains espaces au détriment d’un territoire français où l’on se permet beaucoup moins d’attention. En parallèle de cette politique de protection, la France s’urbanise, les campagnes continuent à se dépeupler et la population française devient de plus en plus urbaine. Cette transition va provoquer une nouvelle demande sociale, notamment en matière de « tourisme vert ». Aujourd’hui plus que jamais, les urbains ont besoin de se ressourcer dans des espaces et des paysages qu’ils souhaitent authentiques et proches de la nature. C’est dans ce contexte que l’auteur s’interroge sur ce que la société nomme « nature » et les différentes représentations qu’elle lui confère. Nos politiques de protection et d’éducation à l’environnement sont elles les bonnes ? Quel sens donne notre société et les acteurs du territoire au terme "nature" ? Ce que l’on nomme « espace sauvage » l’est-il vraiment ou ne serait-ce pas des milieux adaptés à une certaine vision que l’on se fait de la nature? Autant de questions qui alimentent la réflexion de Terrasson que nous allons découvrir ensemble.
La nature, le spontané et l'émotion
Dans ses ouvrages, Terrasson tente de définir le concept de Nature, étrangère mais propre à l’homme également. Comme nous le verrons ensuite, cette définition, se nourrissant de la notion du « spontané » et du « non volontaire », permettra d’appuyer sa critique de la protection de la nature en France.
La nature peut être définie comme « tout ce qui existe en dehors de toute action de la part de l’homme ». Ainsi, un milieu naturel sera constitué d’une biocénose possédant sa dynamique propre, non perturbée, non bloquée par l’action humaine. Cette définition rejoint le concept de nature sauvage… libre. La nature réside dans le non volontaire, dans le non spontané. « La peur de la nature » met en exergue certaines représentations de la nature dans la société qui représente cette liberté, notamment dans les contes et la symbolique. Prenons l’exemple du diable. Celui-ci est représenté par un animal possédant cornes, queue, sabot correspondant « au symbole du mouvement spontanée de la force animale de l’élan de vie sans contrainte ».
Cette spécificité induit qu’il existe également de la nature dans l’homme qui se manifeste par l’inconscient et l’émotion, phénomènes non maîtrisés par la volonté. Une personne naturelle sera celle qui laissera apparaître son émotion et ne tentera pas de la bloquer ou de la freiner. Ainsi, les artistes, les fous et les chamans sont considérés comme des êtres spontanés et naturels car ils donnent libre cours à leurs émotions.
La peur de la nature
De quoi a-t-il peur ? L’homme moderne a peur de ce qui ne porte pas sa marque, de ce qui n’est pas né de sa main. Peur du spontané, qui ne peut pas se prévoir, qui échappe à sa logique. Autrement dit, peur de ce qui échappe à son contrôle. Au bout du compte, la réaction connue de l’homme face à ce qui lui oppose une « résistance », c’est la destruction ou la maîtrise.
Les opinions et réactions sont diverses devant le milieu « naturel ». Les mythes et les légendes sont toujours en relation avec la nature : grotte, serpent, marais, forêt profonde, source jaillissante. On s’enfonce dans les songes, dans des couloirs souterrains sans fin. C’est bien là que veut nous envoyer Terrasson, dans notre inconscient, celui qui nous dirige face à la multitude d’aspects naturels nous donnant des sensations : de l’attrait à la répulsion.
La nature produit l’éveil de la pensée émotionnelle, de l’inconscient construit avec des symboles donc non intelligibles rationnellement. Les profondeurs de notre corps correspondent au profondeur de la terre d’où la peur du sombre, des souterrains mis en comparaison avec les profondeurs de son inconscient, ses instincts, son animalité donc non raisonnable. Les symboles ingérés, le vécu de chacun amène à percevoir différemment l’environnement : gestes, affiches, médias, contes et éducation modèlent nos comportements. C’est ainsi que la nature est mise en conflit avec l’Homme puisque la sensation de présence de la nature réside dans l’existence du spontané, du non volontaire, de la possibilité d’échapper largement à la marque des hommes: « lorsque l’on force la dose de nature, il y a libération des émotions inconscientes »
Les sociétés se projettent sur le territoire qu’elles aménagent et c’est ainsi que l’homme a tendance à détruire ce qui lui fait peur donc le « trop naturel ». Ainsi, s’il redoute la nature et son caractère « hors humanité », c’est de sa propre nature, de ses propres replis insondables que l’homme a peur. La nature de l’homme est « la part la plus sauvage, la plus obscure, mais aussi la plus féconde : ses émotions, ses instincts, ses pulsions ». C’est pour cela que Terrasson affirme « que la nature nous révèle à nous même, et que l’on ne peut vivre en parenté avec la nature sans comprendre ce que nous sommes ».
Le « paradoxe de la société post-moderne »
Dans une société moderne, froide, sans horizons, la nature apparaît comme une échappatoire, une respiration, un idéal d’authenticité, la garantie d’un espace de liberté [3]. Cependant, et c’est là que réside la contradiction, la recherche de nature présente des faces antinomiques.
Cette recherche revêt une volonté de profiter d’une nature « naturelle », de la consommer sans entrave (au moins en apparence). La nature est alors une parenthèse, une bulle, dans laquelle l’homme veut maximiser, optimiser le plaisir qu’il ressent. La nature est vécue comme un décor, non pas comme un milieu vivant avec lequel l’homme entre en « communication ». La nature doit donc correspondre à ce que l’homme attend, un objet prêt à consommer, moulé sur le mode urbain. Elle n’existe pas en dehors de l’homme, la nature n’est donc plus la nature. Dans le cadre de cette première approche, l’authenticité, qui n’est que toute relative, a une valeur instrumentale.
En opposition, selon François Terrasson, la « plénitude authentique » que l’on ressent en se trouvant dans la nature ne peut se trouver que dans le respect de son altérité. Une immersion, la conscience d’une réalité qui nous est (au moins un peu) extérieure, indépendante de nos désirs, une spontanéité qui ne se commande pas. L’authenticité est ici une valeur morale. Quelque chose que l’on ne peut posséder au risque de le voir disparaître. C’est avoir conscience de cela qui distingue les deux approches.
L’auteur développe toute sa réflexion sur le constat initial que notre civilisation s’oriente nettement vers le premier type de relation. Si elle définit la nature comme ce qui fonctionne sans son intervention, en définitive, faut-il de la nature ? L’approche de la nature véhiculée par notre société formule une réponse complexe et ambiguë.
Le rapport à la nature de notre civilisation tel que le décrit Terrasson relève d’un rapport au « sauvage, version sécuritaire ». La "vraie-fausse" nature, la nature recréée. La nature à l’image de l’Homme. C’est le postulat de la « Civilisation anti-nature ». Le sauvage ne doit pas être synonyme de chaos. Il doit être conçu dans un objectif d’accueil, pour que nous puissions facilement et rapidement prendre notre « dose de nature ». Sont donc formulés simultanément des énoncés contradictoires : le désir d’une nature sauvage mais sécurisée, naturelle mais arrangée. C’est la « double contrainte » qu’évoque Terrasson. Le fait de vouloir une chose et son contraire. De faire du faux qui ressemble au vrai, parce qu’on ne veux pas du vrai. Mais pourquoi la civilisation moderne veut-elle une nature aseptisée, contrôlée, sans surprise et sans risque ? Nous l’avons vu, l’auteur avance une réponse claire : « parce que l’homme a peur de la nature».
L’homme repeint la nature à des couleurs acceptables (il faut comprendre : qui ne lui font pas peur). Il fait des espaces ruraux et des espaces naturels des lieux qui font partie de la société, avec leurs fonctions bien précises définies selon les normes de la ville, « digérées » par elle. C’est réussir de manière écologique le projet de rendre conforme la nature à une image conçue par nous. Et, au besoin, contre la nature elle-même. Les hommes, les gestionnaires, les politiques mettent à la place du vrai « les images de leurs fantasmes, tout en se faisant croire non seulement qu’ils ne touchaient à rien, mais qu’ils améliorent. ». C’est là toute l’ambiguïté de la relation moderne à la nature : « l’élément de la nature ne doit le maintien de son existence qu’à la condition de devenir autre chose que lui-même ».
On comprend donc la fonction des espaces protégés : François Terrasson les pense comme une « méthode d’intégration au monde urbain des espaces qui auraient eu le plus tendance à lui être rebelle ». La nature est intégrée dans le système. Elle est humanisée. C’est le « grand mouvement de désauvagisation ». L’homme se place en conducteur des processus. Il se crée tributaire du maintien de l’équilibre des facteurs physiques. Nous aidons à la nature « à être plus naturelle ».
Or, Terrasson le répète inlassablement tout au long de son ouvrage, « un lieu de nature, pour être vraiment tel, ne doit pas être institutionnalisé ». Par institutionnalisation, l’auteur entend la démarche de faire entrer la nature dans le système. De lui appliquer officiellement notre échelle de valeur. En devenant officielle, « l’écologie se passe de désir ». « Si l’inutile est sacré utile, il n’y aura plus rien qui ne soit dépourvu d’utilité. Tout sera intégré. La nature est pervertie par notre volonté. Notre exigence de faire par préméditation ce qui ne peut être fait que sans vouloir». Si la nature est ce qui existe hors de l’homme, alors gérer la nature c’est la dénaturer. La vider de sa substance. Car la nature est le domaine du spontané. Or, on croit que l’authentique peut se décider. Que leur manque t-il à ces imitations que l’homme crée ? Il leur manque d’être vraiment ce qu’elles sont.
Une critique de « l’éducation à l’environnement » laissant peu de place à l’émotion
L’auteur soulève le problème de l’éducation à l’environnement en France qui lui semble faire fausse route. Celle ci ne laisse pas assez de place à l’émotion et se contente d’éduquer par l’information : « on veut apprendre d’abord en donnant une foule d’information scientifique : c’est une erreur [car] connaître pour aimer [...] c’est mettre la charrue avant les bœufs ». A travers cette citation, la priorité pour l’auteur est de susciter de l’émotion chez le public. Pour lui, il faut aimer pour connaître. Par conséquent, l’éducation à la nature doit se faire avec des scientifiques mais également avec des artistes qui invitent à l’émotion. D’autre part, les espaces naturels protégés français sont trop balisés et aménagés de pancartes, d’interdictions ou encore d’observatoires à faune sauvage. Ces éléments présents dans les espaces dit « naturels » marquent la présence de l’homme et coupent le lien direct entre l’observateur et le milieu sauvage : « ainsi, il y a la perte du sentiment exaltant d’espaces authentiques, puissants, sauvages et libres… et c’est bien cette émotion qui disparaît dans le public ». Mais cette limitation de l’émotion est expliquée par nos sociétés qui laissent peu de place à la spontanéité, voulant la maîtriser car… elles en ont peur!
La nature relève t’elle seulement du sauvage ?
Certaines contradictions apparaissent quant à la définition que donne l’auteur à ce que l’on appelle communément « un espace naturel ». Sa définition principale semble être celle d’un espace sauvage retiré de toute action humaine si l’on se réfère à son attachement au non volontaire, aux dynamiques naturelles et à son violent attachement aux fourrés et aux ronces. En opposition, il souhaite « une gestion écologique de tout le territoire, avec des vaches, des moutons, des agriculteurs et des espèces rares dans un modèle global d’aménagement qui fasse que l’on ne soit plus obligé de séparer les espaces protégés des autres espaces ». Ainsi, cette dernière citation montre bien qu’il considère que la nature est partout, même où l’homme occupe le territoire par l’agriculture. En fait, c’est bien la critique de l’espace protégé que certains gestionnaires et militants associatifs désignent comme seul endroit de nature sauvage et authentique que Terrasson souligne. Conserver la nature, dit-il, est une « double contrainte » qui n’a pas de sens. De plus, « il n’y a pas de réserves sans anti-réserves » c'est-à-dire des espaces où l’Homme peut se permettre de négliger les équilibres des écosystèmes. Ce point de vue est partagé par Bernard Kalaora [4] qui a pu dégager une certaine représentation de la nature dans la société contemporaine: « la nature naturelle y est souvent définie comme nature protégée, le sauvage et son caractère d’authenticité n’étant reconnu que dans les cas où la nature est mise en réserve. Paradoxalement la nature sans protection est l’anti-nature, lieu où se greffent les fantasmes et les phobies liés à la pollution, au désordre et à l’insécurité ». Terrasson ne veux pas séparer l’homme de la nature et les mettre en conflit, c’est pour cela qu'il possède une vision écocentrique de la nature, vision initiée par Aldo Léopold dans l'"Almanach d’un comté des sables". Comme le souligne Catherine Larrère [5], nous partageons, avec les autres êtres vivants, une histoire commune, celle de l’évolution. Toutes les espèces ont évolué à partir de la même origine, nous n’avons pas été créés à l’image de Dieu, mais nous avons co-évolué avec les autres espèces, « l’Homme n’est qu’un compagnon voyageur des autres espèces dans l’odyssée de l’évolution », affirmait Léopold. Ainsi, la nature ne relève pas que du « sauvage » et de la non action de l’Homme… car celui-ci en fait partie.
Orienter, est-ce transformer ?
La défense de la naturalité telle qu’elle est menée par l’auteur est cohérente : se basant sur le principe que gérer la nature c’est la dénaturer, il avance son idée d’une refonte des bases de l’aménagement du territoire. La gestion c’est l’artificialisation: en route donc vers la non-gestion ! Il s’agirait de tant vouloir une nature non gérée « que toutes les pratiques seraient orientées vers la sauvegarde de vastes espaces de nature sauvage ». Soit, mais n’est ce pas là une forme de gestion en soit, cela ne relève t-il pas d’une sorte de génie écologique ? Malgré le fait que le but de nos actions serait plus noble et plus réfléchi qu’auparavant, il n’en resterait pas moins que nous interviendrions toujours sur la nature. Pour reprendre les mots de Jean Claude Génot (2003), il s’agirait d’un « pilotage avec la nature » (et non pas contre). Mais cela reste du pilotage ! Orienter, est-ce transformer ? D’après l’auteur, c’est le cas, ce qui met en évidence une première contradiction. A moins qu’il faille assouplir la définition de « nature », en réservant les milieux non (ou très peu) marqués par l’homme au terme de « sauvage », et les milieux « orientés » par cette idée de self-maintenance au terme de nature à proprement parler.
Quel point de départ pour la self-maintenance ?
Au delà d’une évolution des mœurs, quel point de départ l’auteur envisage t-il pour la nouvelle gestion globale proposée, si différente de ce qui existe ? Peut-on partir de la situation actuelle, fragmentée, « cloisonnée » ? Ou faut-il faire marche arrière ? Peut-on « lever les frontières » des réserves ? Mais une nature non appropriée, est ce seulement envisageable dans notre société ? Au final, pour préserver la nature faut il encourager ou limiter la propriété ?
L’homme, « maladie et virus » de la nature ?
Nous adoptons le point de vue de l’auteur lorsqu’il déclare : « On pourrait se dire qu’au point où elle en est, la nature a besoin de l’homme ». Là encore se terre un paradoxe qu’il dénonce: « c’est une belle idée que d’injecter la maladie pour se rendre ensuite indispensable comme médecin ». Cependant, au même titre que sa remarque coule de source, nous lui opposons une autre évidence : celle, un peu facile, de dire qu’il ne faut pas toucher à la nature. Parfois, ne rien faire est aussi dommageable qu’agir.
Une vision tranchée sur un mode dialectique
L’auteur livre dans ses deux ouvrages un plaidoyer passionné et argumenté pour une nouvelle vision de la nature. Le ton est ironique tout en étant enjoué, parfois même cynique. L’abondance de détails précise et illustre le propos. Propos parfois peu nuancé, notamment du fait que l’auteur peut donner l’impression de tomber dans la vision binaire qu’il réprouve (nature/ société). Il dénonce la civilisation de l’Homme sans la nature, propose en réaction la maintenance de la nature sans l’Homme. Bien que sa vision soit clairement celle d’une nouvelle relation entre l’humain et le naturel, cette dichotomie peut gêner.
Sur la forme, François Terrasson est cohérent jusque dans sa manière d’écrire. Il donne au fil de son discours des éléments qui nous renvoient littéralement à notre propre vision des choses, loin de l’accompagnement excessif et de l’absence de réflexion qu’il rejette également.
Au fil de son analyse des politiques modernes de protection de la nature, l’auteur pose les jalons d'une nouvelle vision, d’une nouvelle éthique de la nature. Pour lui, c’est la question de l’aménagement et de la gestion du territoire tout entier qui se pose. Logiquement, François Terrasson en appelle à un aménagement du territoire qui intègre les facteurs écologiques sur tout l’espace national, une politique de protection de la nature qui empiéterait le moins possible sur les dynamismes naturels. L’auteur attend de cette nouvelle vision que la nature soit protégée par les circonstances, et non par la volonté. Car toutes les autres voies conduisent à la dénaturer d’une façon ou d’une autre. Autrement dit, il faut créer les circonstances du maintien des milieux naturels. Ce que l’auteur appelle le « maintien automatique de la nature » ou self-maintenance, la nature « par elle même ». Créer et maintenir les conditions générales de gestion qui font que la nature ordinaire comme la nature "extraordinaire" (qui ne s’appellera plus comme ça) se maintiendront.
Marie Laure GEAI, Sébastien SOL, Damien UNTERNER - Février 2008
[1] Titre inspiré de l’entretien qu’il donna pour le magazine Terre sauvage n°197 (aout 2004), page 90 à 93.
[2] Rolland Miller (2007), Biographie de François Terrasson, dans La peur de la nature, page 243 à 250.
[3] La nature entre désir et réalité : conserver ou consommer la nature, les paradoxes du culte contemporain de la nature, dans Actes de colloques du 6 février 2007 de FNE La nature : l’usage change(ra)-t-il la propriété
[4] La nature entre désir et réalité : conserver ou consommer la nature, les paradoxes du culte contemporain de la nature, dans Actes de colloques du 6 février 2007 de FNE La nature : l’usage change(ra)-t-il la propriété , p 41.
[5] Larrère Catherine (2006), Éthiques de l’environnement, dans Multitudes n°24, pages 75 à 84, Association Multitudes
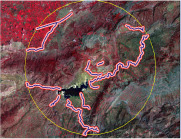

Commentaires